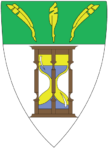Le mot du directeur
Le mot du directeur : Discipline et utilité
Il y a des signes qui ne trompent pas. Au lycée Ermesinde, les élèves évoluent dans le calme. C’est ce que tous les visiteurs nous font observer. Voyant nos élèves dans les maisons, dans les entreprises, au restaurant, au café, au jardin, ils parlent d’« élégance » et de « fluidité », impressionnés par le naturel et le relâchement avec lesquels les élèves vaquent à leurs occupations y compris aux plus exigeantes et contraignantes. Nous nous félicitons bien sûr de ces observations. En même temps, cela nous rappelle que nous jouissons sans doute au lycée Ermesinde de conditions privilégiées. Celles-ci se laissent expliquer ou bien par la supposition que tous nos élèves viennent de milieux avantageux ou bien par une façon de procéder fondamentalement différente des autres écoles. Vu que nous demandons des lettres de motivation et que nous menons des entretiens d’admission, on ne peut écarter entièrement la première hypothèse. Il est en effet probable que la plupart de nos élèves viennent de familles sensibles à une éducation de qualité et soucieuses d’une orientation efficace et réaliste. Pourtant, cela ne suffit certainement pas
Le mot du directeur : Performance
Comment peut-on croire que la performance pourrait être liée à la pénibilité et à l’isolement ? C’est pourtant un préjugé largement répandu et c’est exactement ce qui se passe toujours dans les écoles du monde entier. Voilà par contre des instruments parfaits pour la sélection d’une élite… soumise. Tant que les critères de réussite consistent à reproduire ce que les programmes prescrivent et ce que les professeurs véhiculent, l’école ne produit que quelques gagnants soumis et beaucoup de perdants dépités. La performance n’a aucune chance dans une telle école de se développer, en tout cas pas celle dont le monde a urgemment besoin. Il est scandaleux que l’école commune fait mine de soutenir les qualités qu’elle ne fait que détruire : l’engagement, le talent, l’intérêt, l’originalité, l’authenticité, l’honnêteté, la profondeur, la compréhension et surtout l’échange. La performance véritable, celle qui mérite le nom et celle qu’on peut et qu’il faut attendre de tout un chacun, se développe rapidement et durablement à deux conditions : la facilité et l’échange. Soyons honnêtes : la diversité reste l’ennemi de l’école. Au lieu d’exiger que tout un chacun s’engage
Le mot du directeur : Capital et bonheur
Le lycée Ermesinde n’est pas un lycée de proximité. Son existence dépend de ses clients, au sens romain du terme, de ses protégés. S’il n’y avait pas d’élèves désireux de venir se placer sous la protection du lycée Ermesinde, celui-ci ne pourrait plus exister, car nul ne peut y être placé contre son gré. Le lycée Ermesinde n’a jamais manqué de clients. Les demandes d’admission ne peuvent malheureusement pas toutes être honorées. Que viennent chercher ces élèves et ces parents de plus en plus nombreux ? Comme annoncé, les élèves sont en premier lieu en droit de trouver protection. Protection contre quoi ? D’abord protection contre l’isolement et la peur. Contrairement aux écoles conventionnelles, le lycée Ermesinde mise sur la coopération et sur la diversité. Le principe du traitement égal a malheureusement fini par installer un peu partout une évaluation strictement individuelle et toujours plus standardisée. Or c’est exactement ce qui isole et ce qui fait peur. C’est aussi ce qui s’oppose à un apprentissage et une éducation efficaces. Les incessants devoirs en classe empêchent en large partie la discussion, la réflexion,
Le mot du directeur : Contenu
Il y a deux façons certaines de ne pas être dans le contenu : les programmes et les méthodes. Dans les écoles communes, la réussite de l’élève se mesure à sa capacité d’assimiler des programmes prescrits. On lui demande de donner des réponses prescrites à des questions prescrites. Tout est connu d’avance. On est d’office dans l’artifice. Pourquoi répondre à l’autre alors que celui-ci ne veut entendre que la réponse qu’il connaît déjà et qui est celle qu’il a annoncée et présentée en long et en large, alors qu’il ne s’agit même pas de sa propre réponse, mais de celle prescrite par le programme. Le manque de motivation, le manque de performance et l’indiscipline sont les suites logiques de cette manière de procéder. C’est le désintérêt qui répond au désintérêt. La meilleure manière de ne pas sortir de ce cercle vicieux consiste à chercher à sauver la mise en se tournant vers les méthodes. Comment ruser pour que l’élève ne s’aperçoive pas de la supercherie ? Toutes sortes de méthodes didactiques et pédagogiques ont été inventées ces dernières années et diffusées parmi
Le mot du directeur : Enseignant
Qu’attend le lycée Ermesinde de ses enseignants ? De s’associer avec leurs élèves engagés, de mener l’enquête avec leurs classes, de s’intéresser aux entreprises, de se cultiver, de coopérer, d’écouter, bien sûr, mais aussi et avant tout d’entretenir les mêmes relations intellectuelles et amicales avec leurs élèves qu’avec leurs collègues. L’âge d’entrée au lycée marque la fin de l’enfance. C’est en tout cas un moteur formidable que de le supposer, de travailler, de converser, de réfléchir avec les élèves comme avec des adultes, de placer a priori la même confiance, les mêmes attentes, la même curiosité et le même amusement dans les rapports avec les jeunes gens que dans les rapports avec les adultes. L’âge de 12 ans est tranchant. Voir l’élève comme un adulte ouvre toutes les portes. Le voir par contre comme un enfant, comme un élève auquel il faudrait tout apprendre et dont on ne pourrait rien apprendre, ne pardonne pas. C’est tout ou rien. Exploiter l’incroyable potentiel des jeunes gens à cet âge apporte tout, la discipline, l’excellence, la rigueur, la connaissance et le plaisir. S’acharner par contre à
Le mot du directeur : Le producteur-roi
L’alimentation a toujours compté parmi les préoccupations principales du lycée Ermesinde. Tout est dans l’alimentation : la culture, l’économie, le goût, la convivialité, l’artisanat, l’environnement, l’histoire, les bonnes manières, l’art, la politique, la nature, l’industrialisation, la mondialisation, etc. Les enjeux liés à l’alimentation sont probablement déterminants pour l’avenir de notre espèce et de notre planète. La surconsommation et une production responsable ne font pas bon ménage, rien n’est plus clair. D’un autre côté, arracher les consommateurs à ses habitudes et à ses « acquis » ressemble à une mission impossible. L’exemple du lycée Ermesinde donne de l’espoir. Depuis des années, nous essayons de concevoir une politique ou plutôt une philosophie d’achat responsable. Comme toujours, nous puisons dans nos ressources internes et externes pour entendre plusieurs voix et pour saisir toute la complexité de cette partie de l’économie. Ainsi nous formons continuellement des experts un peu partout : dans les recherches menées dans les branches interdisciplinaires, dans les travaux personnels et dans les mémoires, et surtout dans les trois entreprises « SEEFOOD » (de SEE – société, économie, environnement, comprenant le Restaurant Mélusine et le
Le mot du directeur : Etudes
L’amitié est au cœur de la philosophie du lycée Ermesinde, au sens de philia, d’une amitié à la fois vertueuse et intéressée. L’intérêt mutuel de l’échange va de soi dans les entreprises. La transmission et la coopération y sont nécessaires, car l’interdépendance entre les différents acteurs est totale. Les élèves y font l’expérience de l’intérêt mutuel consistant à exploiter la diversité des talents, des styles, des personnalités, des connaissances. Ce faisant, ils participent évidemment à la réussite et à l’enrichissement de l’entreprise, mais ils entretiennent aussi le développement moral et intellectuel parmi le personnel de l’entreprise. La performance des entreprises prouve que le plaisir et la performance sont les deux conditions d’une réussite à la fois personnelle et collective. Les cours qui ont lieu dans les maisons méritent les mêmes conditions ! Hélas, la tradition des cours dans les écoles est tout autre. Dans un système promotionnel et standardisé, les cours sont plutôt marqués par la méfiance, la concurrence et la soumission. Au lieu d’être associés, les acteurs, élèves et professeurs, sont isolés et séparés. La performance et la motivation en
Le mot du directeur : Orientation
Au cycle inférieur du lycée Ermesinde, le bulletin est radicalement orientatif. Il apporte à l’élève une appréciation du bien-fondé de son projet personnel, sur base de son travail personnel, de son entreprise et de ses branches favorites. Pour les jurys externes, chargés d’avaliser le projet personnel et la classe de spécialisation correspondante, les travaux personnels constituent généralement les pièces les plus impressionnantes et les plus convaincantes. Pour ce qui est des branches, l’élève en a deux où la logique veut qu’il soit particulièrement bon et où il met ses talents au service de ses camarades. Ces deux branches sont en principe celles qui s’approchent le plus du projet personnel. Rien de tout cela ne se fait dans d’autres lycées. La logique y est complètement inversée. Globalement, ce n’est pas la diversité ni l’excellence qui y sont recherchées, mais plutôt l’uniformité et la moyenne. Tous les élèves sont évalués exactement de la même manière, selon les mêmes critères et au même moment, indépendamment de tout projet d’orientation. Leur engagement se limite à la reproduction des programmes ou alors
Le mot du directeur : Cycle supérieur
Le cycle inférieur du lycée Ermesinde a vocation d’orienter l’élève vers la spécialité qui lui convient le mieux. Si celle-ci se situe dans le régime classique, il effectue le cycle supérieur au lycée Ermesinde dans la section la mieux adaptée. Le cycle supérieur a une double vocation : 1) préparer aux études supérieures et à la vie professionnelle ; 2) préparer au diplôme de fin d’études secondaires. Après le cycle inférieur du lycée Ermesinde, l’élève a des capacités élevées en coopération et en recherche. Ce sont des capacités très utiles et très demandées dans le monde universitaire et dans le monde du travail. Au cycle supérieur, l’élève étend ces capacités 1) en effectuant un mémoire collectif en 3e et un mémoire individuel en 2e ; 2) en continuant de travailler en entreprise. Pour ce qui est de la préparation à l’examen de fin d’études secondaires, il partage à présent avec ses camarades de section le même dessein. Les programmes et les exigences sont à présent clairement définis et il s’agit de s’approprier, individuellement et collectivement, les connaissances et les stratégies les plus efficaces pour
Le mot du directeur : Tâche de l’enseignant
Il n’y a guère de métier qui concilie davantage l’intérêt individuel et l’intérêt collectif que celui d’enseignant. Il revient à l’enseignant la noble tâche de s’enrichir au profit de ses élèves. Il puise dans ses élèves, dans leur diversité et leur fraîcheur, une culture et une jeunesse toujours renouvelées. Tout ce qu’il a à investir, c’est de l’intérêt, son propre intérêt. Tout ce qu’il a à faire, c’est d’être et de rester dans la demande, car les jeunes gens ne demandent rien de plus qu’on leur adresse des demandes intéressés. Les jeunes gens sont naturellement versés à donner. A recevoir, ils ne s’intéressent que pour donner plus. Pour apprendre, l’enseignant peut compter sur l’élève, ce matériel humain sans cesse régénéré et toujours disponible. Il faut et il suffit de lui faire confiance. En vérité, il n’a pas le choix. Ou bien il utilise ses élèves pour se cultiver, pour son propre salut et pour le salut de ses élèves, ou bien il s’épuise et se frustre en voulant donner là où il est de rigueur de s’élever. Tout le
Le mot du directeur : Patrimoine
Rousseau identifie la perfectibilité et l’historicité comme étant les deux caractéristiques essentielles distinguant l’homme de l’animal. La perfectibilité de l’homme se trouve liée à sa capacité de s’arracher à la nature, de développer petit à petit une culture et une moralité tendant vers la sagesse et la vertu. L’homme est en outre doté d’une double historicité, individuelle et sociale, dans le sens où ce développement dépend de ses conditions de vie individuelles et sociales. La perfectibilité rend possible et nécessaire l’éducation, se confondant, au sens général, avec l’histoire personnelle. La perfectibilité et l’historicité de l’homme fondent sa diversité. La diversité est communément reconnue pour prévenir la tyrannie (Montesquieu), pour engendrer la tolérance et la paix (Voltaire), pour engendrer la richesse, la complémentarité et la coopération (Rousseau). L’école dite républicaine, pourtant, dans son élan d’égalité, a du mal avec la diversité. Afin de garantir l’égalité des chances, elle privilégie la neutralité. C’est bien pour cela qu’elle a tendance à être entièrement dans la transmission. Elle ne veut pas entendre ce qu’elle n’a pas donné elle-même. C’est pourquoi elle emploie
Le mot du directeur : Intérêt
Étymologiquement, le terme d’« éducation » est intéressant. Il vient de educare, ce qui signifie littéralement « conduire hors de ». Mais hors de quoi ? Hors de l’enfance ? Hors de l’ignorance ? Une autre interprétation peut être avancée, permettant mieux de comprendre une composante essentielle de la pédagogie du lycée Ermesinde, à savoir celle consistant à prendre comme objet de l’éducation non pas l’élève mais le savoir ! L’éducateur, au lieu de tirer l’élève hors de l’enfance par le savoir, s’applique à tirer le savoir de l’élève. L’expérience des branches interdisciplinaires et des entreprises du lycée Ermesinde montre que l’élève a tout à offrir et s’élève en allant chercher les savoirs et en les produisant, plutôt qu’en les consommant. La condition en est qu’il y ait une forte demande, une demande réelle et sincère. L’éducateur, au lieu de donner, compte sur les élèves pour nourrir ses propres intérêts. Au lieu d’être dans l’offre, il est dans la demande. Son engagement, loin d’être désintéressé, consiste à s’enrichir et à se cultiver grâce aux apports des élèves. Son intérêt consiste à questionner et à écouter. Sa
Le mot du directeur : Service
Au lycée Ermesinde, le service est la clé de l’apprentissage. L’élève prend l’habitude de se mettre au service des autres. Dans l’entreprise, son destinataire n’est pas seulement le public ou la clientèle, mais aussi ses jeunes collègues qu’il est appelé à initier. La même chose vaut pour les engagements dans les maisons. Chaque élève se met, dans ses deux branches de prédilection, au service de ses collègues, dans la classe et dans les études. Aider quelqu’un profite évidemment à l’autre, mais encore plus à soi-même, car il n’y a guère de meilleure méthode pour éprouver et renforcer son propre savoir que de tenter de le transmettre. Les études sont entièrement consacrées à la coopération et à l’entraide. Les élèves engagés y coopèrent pour effectuer leurs recherches et pour préparer leurs interventions. De plus, ils se tiennent disponibles pour aider des élèves qui ont des difficultés ou qui veulent s’exercer. Cette pratique est très éloignée des devoirs à domicile que les élèves sont censés faire seuls à la maison sous la férule de leurs parents. La coopération a ce
Le mot du directeur : Gratuité
Il y a des mots que l’air du temps fait souffrir. La « gratuité » est un mot particulièrement malmené par l’économie d’aujourd’hui. Sa signification, devenue largement monétaire, a malheureusement enfoui sa splendeur originelle. S’il est légitime aujourd’hui de se méfier de tout ce qui est gratuit, le sens originel du terme relève d’une innocence aussi noble que suave. Gratis (de gratiis) désigne les choses qui sont grata. Or il n’y a guère de terme plus somptueux que gratus. Voyez un peu ses significations selon Gaffiot : agréable, bienvenu, aimable, charmant, ce qu’on accepte avec plaisir et reconnaissance, cher et précieux. Ce qui ne coûte rien apparaît donc comme ce qu’il y a de plus précieux. Ce qui n’a pas de valeur monétaire est ce qui a le plus de valeur. Ce qui est gratuit est libre et désintéressé, par opposition à mercennarius, c’est-à-dire au coût et à l’intérêt. Ce qui est gratuit relève de cette grâce des jansénistes qui ne dépend pas de nous et qui est indépendant de nos mérites. La gratuité en devient parent de la liberté, de l’insouciance et,
Le mot du directeur : Recherche
Comme l’« orientation » et les « compétences », la « recherche » est devenue un terme commun dans le jargon de l’éducation. Il y a quelques années, ce terme était surtout réservé aux chercheurs scientifiques, cloîtrés dans leurs laboratoires, universitaires ou privés, appliqués à déchiffrer la vie et l’univers et à développer de nouveaux produits ou de nouvelles théories. On distinguait tout au plus la recherche fondamentale et la recherche appliquée, mais le terme de recherche ne dépassait guère les sciences naturelles et les sciences théoriques. Aujourd’hui, pour trouver l’horaire d’un bus, on fait une recherche sur internet. Dans les écoles, les élèves se rendent à la bibliothèque pour faire des recherches en groupe. Le développement de l’informatique y est sans doute pour quelque chose dans la vulgarisation du terme, mais aussi dans son appauvrissement. S’il est évidemment légitime de l’appliquer à toutes les sciences et à tous les arts, il est abusif de l’utiliser pour donner à des actions ponctuelles une importance qu’elles ne méritent pas. Pour faire bref, ces actions de recherche sont très souvent incroyablement banales et superficielles. Mais il y a